

La Rincette mimosa
Pour Éric
À La Rincette mimosa, le vendredi, le vin du jour était un jurançon. Sa robe or pâle était en accord parfait avec la couleur des murs du bar dont la baie vitrée, ombrée de paille, s’ouvrait sur le haut du boulevard Longchamp. Ici, tout était jaune ou presque : les murs fleur de soufre, le sol avec une alternance de carreaux miel et chamois, les tables au marbre jaune de Sienne, les chaises en skaï citron, le comptoir en abachi du Sénégal, les pichets d’eau à la couleur et aux armes d’un vieux pastis local, jusqu’à la robe et même la perruque de la patronne, « blond d’argent » aimait-elle préciser quand un client la complimentait sur l’harmonie parfaite de toutes les nuances de couleur rassemblées dans son établissement. On lui donnait du « mademoiselle » bien qu’elle en eût dépassé le premier âge et pas encore atteint le second. Elle y tenait, et le faisait savoir, ce qui ne choquait finalement personne tant, malgré les années et les kilos en trop, elle était restée ronde, rose et pimpante comme un jambon de Parme. Voilà plus de dix ans qu’elle avait ouvert La Rincette mimosa, en lieu et place d’un Garage mécanique et carrosserie chassé du quartier par un voisinage embourgeoisé tenant plus à sa tranquillité qu’à l’entretien de ses voitures et encore moins à la sauvegarde de l’artisanat local. Le garagiste, totalement étranger au concept de gentrification urbaine, lassé par l’hostilité grandissante de ses voisins qu’il avait pourtant bien essayé de raisonner à grands coups de gueule et parfois de clé à molette, peinait à trouver un acquéreur pour un local à l’environnement hostile et surtout considérablement imprégné de graisse et d’huile de vidange des provenances les plus douteuses. Mademoiselle, qui se nommait en réalité Stefania Pellicciàio et qui avait francisé son prénom en Étiennette, disposait de quelques liquidités, durement acquises vingt années durant, entre la rue Barbaroux et la rue Thiers. Et elles grimpent les rues qui mènent de la Canebière à la Plaine ! Bref, à force d’user ses talons sur les trottoirs pentus et les escaliers escarpés des quelques hôtels borgnes des environs, Stefania Pellicciàio, alias Étiennette, possédait un joli tas de billets, certes un peu froissés mais de bonne banque. Confrontée, elle aussi, à une singulière transformation sociologique de son environnement, par l’arrivée d’une population bien charpentée et exerçant une activité qui, pour être proche de la sienne, n’en drainait pas moins une clientèle aux attentes singulièrement différentes, Étiennette avait décidé qu’à près de quarante ans, dont une vingtaine sur le trottoir, il était temps de se ranger des voitures, de partir en pleine gloire en quelque sorte.
Ces deux-là étaient donc faits pour se rencontrer. Pour autant, qu’un romantisme débridé ne nous fasse pas croire que, chassée par les travelos, la prostituée tomba dans les bras du mécano. Le garagiste était marié et heureux en ménage. Et, même s’il n’aurait sans doute pas dédaigné un petit extra, Étiennette, qui avait acquis tout au long de ces années une connaissance approfondie de la nature humaine en général et des hommes en particulier, n’aspirait plus alors qu’à se tenir à distance de ces derniers. Leurs relations étaient donc restées des relations d’affaires. Elle avait payé le local comptant, ce qui avait permis à l’honnête garagiste de dissimuler une partie de la somme au fisc, et donc de consentir à Étiennette une petite ristourne. Enfin, elle avait nommé son établissement La Rincette mimosa en souvenir, si l’on ose s’exprimer ainsi, de toutes ces années de labeur. La « rincette mimosa » était le nom imaginé par l’un de ses plus fidèles clients pour désigner la toilette intime précédant les ébats tarifés dans les bras d’Étiennette qui utilisait exclusivement un savon et une eau de toilette au mimosa qu’elle achetait par correspondance à un célèbre parfumeur grassois. Étiennette, rebaptisée Mademoiselle et parvenue au rang d’honorable commerçante du boulevard Longchamp, s’était dit qu’il ne lui faudrait jamais oublier ni d’où elle venait ni par où elle était passée. Pour le public non averti, le nom avait quelque chose de joyeux et de doux à la fois, très éloigné de la sordide réalité. En bonne fille de Basilicate, région du Mezzogiorno réputée autant pour la qualité de ses gnummareddi, les célèbres tripes de moutons farcies aux abats, que pour la ferveur religieuse de ses jeunes filles, Stefania Pellicciàio songeait chaque jour davantage à rentrer dans les bonnes grâces de l’Église de son baptême. Elle s’en était quelque peu éloignée spirituellement, mais jamais géographiquement. En effet, les rues où elle exerçait son activité peu catholique voisinaient avec l’église Saint-Vincent-de-Paul. L’église Saint-Vincent-de-Paul est plus connue des Marseillais sous l’appellation d’église des Réformés pour avoir été construite au milieu du XIXe siècle sur l’emplacement de la chapelle des Augustins réformés édifiée, elle, au XVIIe siècle. Est-ce cette lointaine référence à l’évêque d’Hippone, auquel fut assez injustement reprochée une certaine complaisance envers la prostitution, ou l’éloquence du jeune curé de la paroisse ? Toujours est-il qu’Étiennette, entrée dans l’église une après-midi de juillet pour y trouver un peu de fraîcheur et un banc pour reposer ses jambes, en était ressortie transformée et reconvertie en « mademoiselle » par le jeune homme qui ne savait trop comment s’adresser à une si singulière paroissienne. Elle devint rapidement un des piliers de la paroisse. Mais, si chaque matin le jeune prêtre remerciait Dieu de lui avoir permis d’arracher aux ténèbres les plus sombres une âme perdue, chaque soir le souvenir de la silhouette sensuelle d’Étiennette enveloppée d’un parfum de mimosa doux et poudré venait le tourmenter, alimenter ses fantasmes les plus fous, et l’empêchait de trouver le sommeil. Des cernes impressionnants sur le visage, il finit par se confier à son confesseur, un vieil abbé au franc-parler plein de bonté et surtout de bon sens. Le saint homme lui évita donc le discours convenu sur les bienfaits de la tentation et la nécessité d’y résister pour l’édification de l’âme. Il lui prodigua les meilleurs conseils, puisque éprouvés sur lui-même bien des années plus tôt. Pour cela, il choisit d’abandonner le vouvoiement indispensable à l’enseignement du maître à l’élève, mais peu indiqué en l’occurrence, et adopta le tutoiement avec un ton qui, pour être familier, ne laissait pas de place à la moindre discussion :
« Tu vas aller t’acheter une paire de baskets, dit-il en sortant de la poche de son clergyman rapiécé un billet de cent francs qu’il venait miraculeusement de trouver dans le tronc de sainte Rita, patronne des causes perdues. Tous les matins, après la première messe, tu vas faire en courant un tour du parc Longchamp. Un tour la première semaine, deux la deuxième, et ainsi de suite jusqu’à quarante. Tous les jours, sauf le dimanche. On va installer un sac de sable dans la petite pièce à côté de la sacristie. Tous les soirs, avant de te coucher, tu feras une demi-heure de sac ; une camomille, tes prières, et au lit. Ça devrait suffire pour te changer les idées. »
Devant le regard incrédule du jeune homme qui s’attendait bien à devoir s’engager sur le dur chemin du repentir et sans doute de la mortification, mais imaginait que cette dernière serait plutôt spirituelle que physique, le vieux prêtre se releva avec difficulté en se frottant les genoux et dit d’une voix forte :
« Comment crois-tu que je me suis bousillé les ménisques, en faisant des génuflexions peut-être ? Pas question ! Moi, je prie debout. »
Et il en fut ainsi.
Jean-Claude GARRIGUES







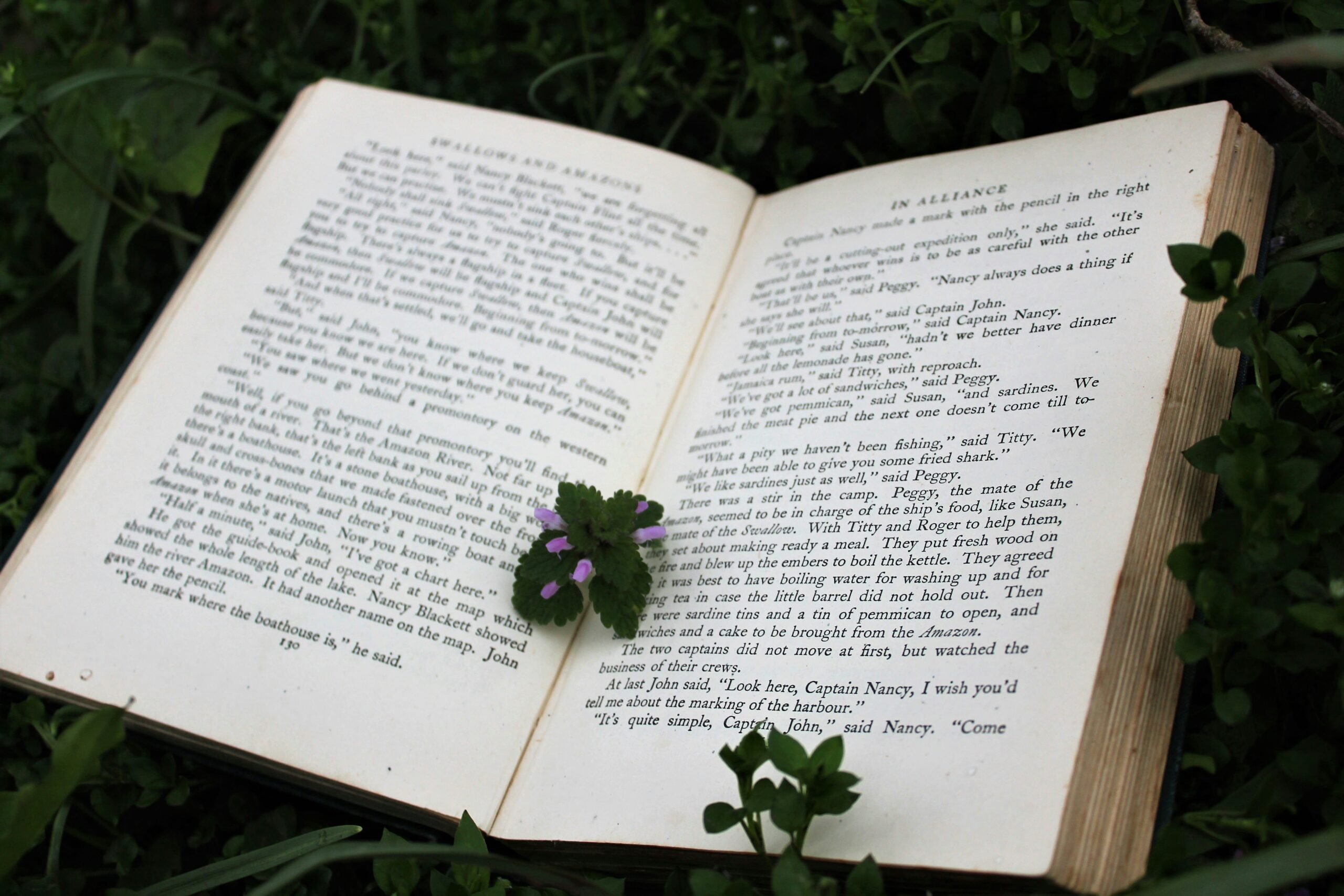






Laisser un commentaire